
Sécurité des médicaments : les aspects liés au sexe
Prise en compte nécessaire avant et après la commercialisation

C’est une notion souvent mal comprise. On l’associe volontiers à la « médecine des femmes » ou aux LGBTIQ. Mais en fait, il s’agit de prendre en compte les différences biologiques et sociales – le sexe et le genre – dans le diagnostic, le traitement et la recherche. Elles influent sur l’apparition des maladies, le type de symptômes et l’efficacité des traitements.
Prenons un exemple classique : l’infarctus du myocarde. Les symptômes décrits sont en général une douleur thoracique aiguë qui irradie dans le bras gauche. Mais les femmes en ont souvent d’autres, comme des douleurs dans le dos, des nausées ou un essoufflement. Comme ils ne sont pas « typiques », le médecin pourra penser, non pas à un infarctus, mais à une crise de panique – avec des conséquences souvent fatales.
Et puis, il y a l’ostéoporose, qui discrimine les hommes, puisqu’elle est considérée comme une « pathologie féminine ». Pourtant, elle touche aussi les hommes – et passe souvent inaperçue.
Les caractéristiques physiologiques et biologiques influent beaucoup sur l’apparition des maladies et l’action des traitements. P. ex. le système immunitaire des femmes est plus actif. Elles sont donc plus sujettes aux maladies auto-immunes, mais souvent moins au cancer. Pour ce qui est des traitements, le problème, c’est qu’en médecine, c’est l’organisme masculin qui est généralement considéré comme la norme. Or, femmes et hommes métabolisent les médicaments différemment. Nombre de substances restent plus longtemps dans l’organisme féminin, entraînant donc plus d’effets secondaires.
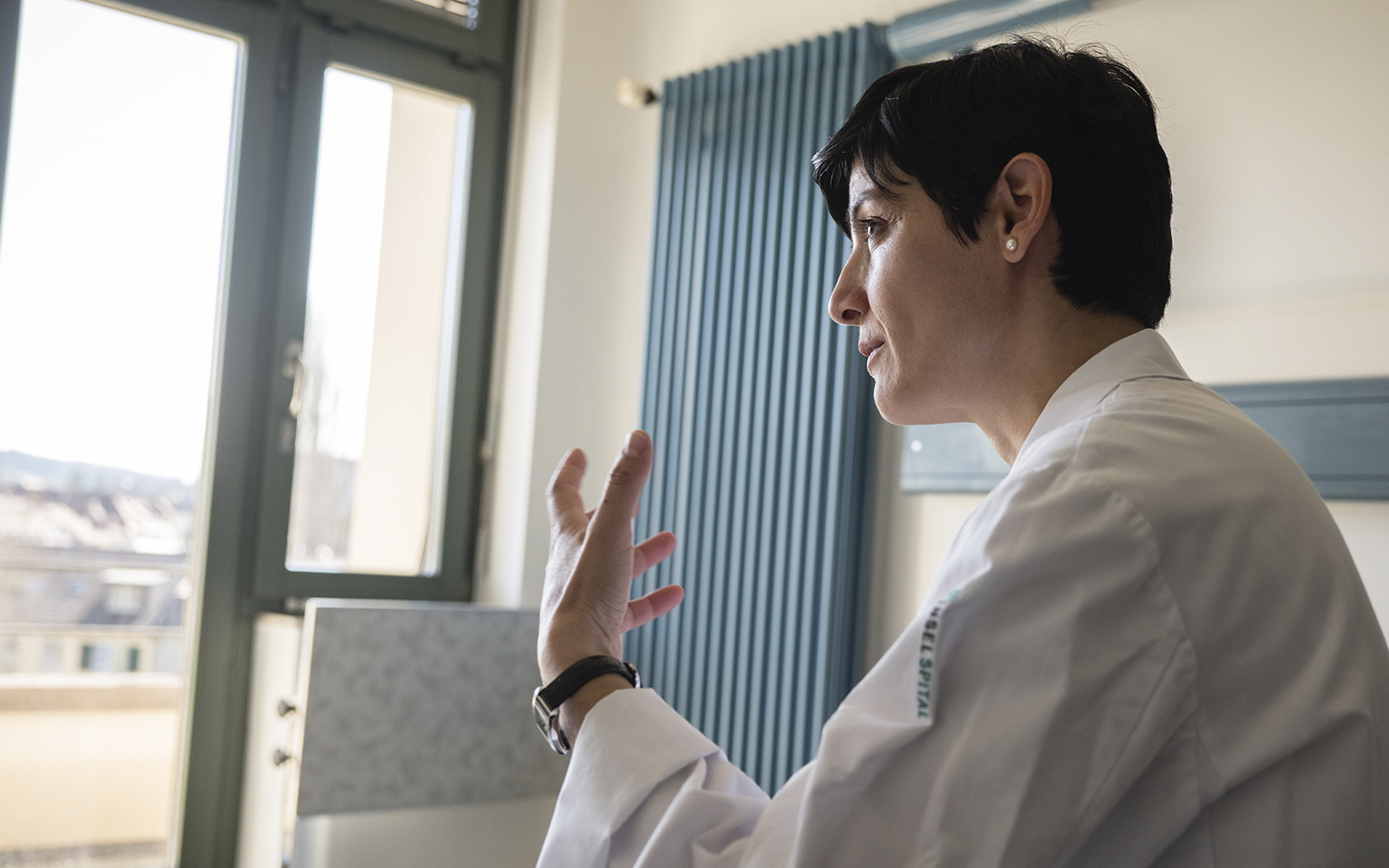
Ils agissent sur la manière dont les malades parlent de leurs symptômes, dont les professionnels de la santé les interprètent et donc, in fine, sur le choix des traitements. Les troubles gastriques ou l’épuisement p. ex. sont souvent vus comme ayant des causes psychologiques chez les femmes – alors que chez les hommes, ils sont investigués. Les femmes tendent aussi à différer la résolution de leurs problèmes de santé, parce qu’elles s’occupent de leur famille et de leurs proches.
Globalement, les hommes sont plus souvent touchés. Mais certains types de cancer, comme celui de la thyroïde ou de la vésicule biliaire, sont plus fréquents chez les femmes. Elles ont généralement un meilleur système immunitaire, qui peut les protéger dans une certaine mesure. Et puis, les œstrogènes, en particulier avant la ménopause, ont un effet protecteur.
Mais outre ces facteurs biologiques, les aspects sociaux jouent également un rôle : en moyenne, les hommes fument plus et boivent plus d’alcool. D’un autre côté, le comportement des femmes en matière de santé est différent et on ne sait pas encore dans quelle mesure le contact (professionnel) avec des produits de nettoyage ou les cosmétiques agit sur le risque de cancer.
Les différences liées au sexe ont un réel impact sur le diagnostic. Le cancer de la vessie p. ex. n’est souvent détecté que tardivement chez les femmes parce que des symptômes comme l’hématurie (présence de sang dans les urines) sont d’abord mal interprétés et la patiente est traitée par antibiotiques pour une infection urinaire.
Les femmes sont plus conscientes des risques de cancers cutanés et se font dépister plus tôt. Leurs mélanomes apparaissent plutôt sur les jambes. Chez les hommes, ce sont plutôt la poitrine et l’abdomen qui sont touchés et ils tardent à se faire examiner, ce qui aggrave le pronostic.
« La médecine genrée n’est pas un phénomène de mode, ça peut être une question de vie ou de mort. »
Les femmes souffrent souvent plus des effets secondaires de la chimiothérapie du fait d’un métabolisme plus lent et d’une masse musculaire plus faible. Les doses de médicaments administrés sont cependant souvent standard, en fonction de la surface corporelle. Ce qui peut leur être fatal. Je me souviens d'une patiente atteinte d'un cancer de la vessie, qui a dû arrêter sa chimiothérapie avant l'opération de sa tumeur car les effets secondaires étaient insupportables, ce qui a réduit ses chances de guérison. Elle est décédée. Sa vie aurait peut-être pu être sauvée s’il y avait eu des options thérapeutiques mieux adaptées.
C’est un cas parmi d’autres, qui montre que la médecine genrée n’est pas un phénomène de mode et que ça peut être une question de vie ou de mort. La médecine doit mieux tenir compte du sexe et du genre pour offrir le meilleur traitement possible à la population – y compris aux hommes. Prenons le cancer du sein, p. ex. : 1 % des cas seulement concernent des hommes. Mais il est souvent traité comme chez les femmes, sans que l’on dispose de données d’études suffisantes pour le justifier.
Parce que les essais cliniques ont longtemps été menés presque exclusivement sur des hommes. Après le scandale du Contergan, on a voulu protéger les femmes : elles ont été exclues des études pendant des décennies. Aujourd’hui encore, elles sont sous-représentées.
L’industrie n’est que peu encline à mener des recherches spécifiques au sexe – elles sont coûteuses et compliquées. Mais au lieu de financer de nouvelles études onéreuses, on pourrait analyser les données cliniques disponibles pour déterminer les différences entre sexes. Adapter le dosage serait déjà une avancée majeure pour réduire les effets secondaires.
L’âge, l’origine ethnique et la situation sociale devraient aussi être mieux pris en compte : les personnes âgées p. ex. sont d’ordinaire exclues, alors qu’elles ont souvent besoin de médicaments et que le métabolisme se modifie avec l’âge, ce qui influe sur l’action et les effets secondaires. Et les différences ethniques jouent un rôle : les Asiatiques réagissent souvent autrement à certains médicaments que les Européens. Enfin, les catégories socio-économiques défavorisées sont plus rarement représentées dans les études. Une recherche médicale plus diversifiée, avec une perspective intersectionnelle, contribuerait à rendre la médecine plus juste.
« Renoncer à des objectifs de diversité dans la recherche clinique pourrait faire nettement régresser le développement de médicaments. »
Il y a des progrès : les lignes directrices telles que les Sex and Gender Equity in Research Guidelines (SAGER) demandent la prise en compte systématique des différences dans la recherche médicale. Les revues scientifiques spécialisées exigent aussi de plus en plus que les études produisent des données spécifiques au sexe/genre. La sensibilisation à la médecine genrée va croissant, surtout chez les jeunes, mais des obstacles structurels empêchent souvent l’accès des femmes à des postes dirigeants. Or, ce sont elles surtout qui font de la recherche sur les différences entre sexes. Sans une présence accrue des femmes à des postes clés, il est difficile de faire de réels progrès dans la médecine genrée.
On voit aussi un changement de mentalité dans l’expérimentation animale et la recherche préclinique : on a longtemps utilisé presque exclusivement des animaux mâles dans les études précliniques, mais de nouvelles directives imposent d’inclure des femelles.
Elle fait l’objet d’intenses discussions dans les milieux scientifiques. Mais il y a des résistances politiques, surtout aux États-Unis où, depuis le début de l’ère Trump, les projets de recherche qui s’intéressent à des populations vulnérables ou à des questions de genre sont pénalisés. Le simple fait d’utiliser certains termes peut entraîner la suppression de subventions ou le rejet de dossiers de recherche.
Si l’on veut vraiment faire progresser la médecine personnalisée, il ne faut pas se laisser décourager par des résistances idéologiques et s’engager résolument en faveur d’une médecine inclusive et factuelle. Renoncer à des objectifs de diversité dans la recherche clinique pourrait faire nettement régresser le développement de médicaments. Nous avons les connaissances sur les différences entre sexes – mais leur mise en pratique reste un défi. Nous devons générer plus de données pour voir des changements concrets. Ce qui aiderait vraiment, ce serait de considérer les femmes et les hommes comme deux populations séparées.
Dans ce contexte, le dosage des médicaments représente un champ d’innovation important. Des facteurs comme le sexe, la taille et le poids devraient être pris en compte dès les premières phases des études – pour augmenter la sécurité et l’efficacité, mais aussi pour poser les bases de traitements plus individualisés.
Pour moi, Swissmedic a un rôle important à jouer. La sécurité des patientes et patients doit rester la priorité et il faut être ouvert à l’innovation, même s’il est difficile d’atteindre la perfection en matière de données.
Dans la médecine genrée, Swissmedic peut insuffler des élans ciblés, ce qu’il fait d’ailleurs déjà en examinant les données des études selon le sexe lors de l’autorisation et en demandant d’autres analyses lorsqu’il manque des données. Ce qui permet de mieux comprendre les différences en termes d’action et d’effets secondaires et d’en tenir compte. Prendre davantage en compte les différences liées au sexe/genre à toutes les étapes, du développement du médicament à son autorisation, permettra d’améliorer les soins médicaux pour toute la population.